En 2012, l’espérance de vie des
Français baissait. Les « grands » médias ont préféré s’abstenir
d’informer sur ce phénomène historique. Il ne fait pourtant que
commencer et nous affectera, à des degrés divers. Les décisions prises
aujourd’hui, loin de l’enrayer, vont aggraver sérieusement le recul de
la longévité française.
Par Benoit Delrue. Lien court : http://wp.me/p6haRE-8x
3 900 mots environ. Temps de lecture estimé : 20 minutes. 
Elle « a marqué le pas en 2012 ». Jamais
à court d’euphémismes pour réduire la portée des faits qui ne rentrent
pas dans ses cases préétablies, l’Insee présente ainsi la baisse
historique de l’espérance de vie française. Et encore, la figure de
style ne peut être lue que dans son commentaire des résultats de l’année
2013, qui voit un léger mieux. L’institut national de la statistique et
des études économiques s’était bien gardé de commenter publiquement ces
chiffres quand ils ont été découverts un an plus tôt ; notre
gouvernement et nos « grands » médias, de relayer l’information.
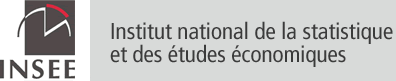
Après une hausse continue depuis qu’elle
est mesurée, l’espérance de vie des hommes de 60 ans est passée cette
année de 22,7 à 22,6 ans. Celle des femmes du même âge, de 27,4 à 27,2
ans. A la naissance, on leur pronostiquait 84,8 ans à vivre, contre 85
années en 2011. La différence n’est pas grande, elle peut même paraître
négligeable pour le profane ; en réalité, elle marque une évolution
sensible, qui tranche avec tout ce qui avait été constaté jusqu’alors.
L’espérance de vie est un calcul réalisé
à partir d’une population fictive, combinée par les taux de mortalité à
chaque âge recensés lors d’une année. Les statisticiens prennent donc
en compte l’ensemble des décès de la population pour projeter une
longévité moyenne. Mais l’espérance de vie ne vaut que si les chiffres –
les taux de mortalité – restent stables, ce qui n’est évidemment pas le
cas. Cet indicateur a confirmé les formidables progrès réalisés par
l’Homme ; mais relayé tel quel, sans autre commentaire que ses données
brutes, il donne l’idée que l’allongement de la vie est inéluctable.
Rien n’est moins vrai.
La hausse de l’espérance de vie est un
phénomène qui a ses propres causes, parfaitement identifiables. Prendre
du recul donne les moyens de mesurer l’évolution probable de notre
longévité, et surtout d’expliquer pourquoi elle stagne et risque fort de
baisser dans les années et décennies à venir.
Médecine et hygiène modernes
C’est tellement évident que rares sont
ceux qui prennent la peine de le rappeler : l’espérance de vie est le
résultat de facteurs économiques et sociaux. Ce n’est donc pas un
phénomène naturel ou génétique, mais un phénomène « culturel »,
structurel et propre à certaines conditions socio-économiques. Au
premier rang des causes de l’allongement de la vie se trouve, sans
surprise, les progrès de la médecine.

Amorcés au milieu du 19ème
siècle, les progrès médicaux sont fulgurants. Le stéthoscope et
l’aiguille apparaissent et transforment le travail médical. La chirurgie
est inventée, avec l’anesthésie et une exigence d’hygiène soutenue.
Pasteur met au point en 1885 la technique moderne de vaccination,
consistant à l’inoculation volontaire des germes causant la maladie –
technique résultant de la connaissance de notre système immunitaire.
L’électrocardiogramme, pour mesurer avec précision le rythme cardiaque,
et les photographies à rayons X sont conçus à l’aube du 20ème
siècle. Puis vient l’émergence des vaccins et des antibiotiques,
l’isolation de substances comme l’insuline, la découverte des molécules
actives et leur synthèse sous forme de médicaments. Les diagnostics sont
toujours plus précis, avec le scanner, l’échographie, l’imagerie par
résonnance magnétique (IRM).
Les progrès économiques ont généré le
perfectionnement du matériel médical tandis que les progrès
scientifiques, les échanges d’expériences pratiques, ont amené
parallèlement au perfectionnement des techniques et des spécialités. Les
maladies sont, toujours, la première cause de mortalité. Mais leurs
ravages sont largement contenus, grâce aux fortes exigences
professionnelles – à commencer par les années d’études – et au
déploiement de médecins sur le territoire français depuis cinquante ans.
De 60.000 à la fin des années 1960, le nombre de docteurs en médecine
est passé à 180.000 en 1992, et environ 210.000 en 2009.
La connaissance de l’anatomie humaine
est également répandue au sein même de la population grâce à
l’alphabétisation et l’instruction généralisées. A mesure que les
médecins appréhendent les mesures d’hygiène les plus efficaces, ces
dernières sont diffusées auprès de tous les Français. Pour les
appliquer, il fallut néanmoins une amélioration considérable des
conditions de logement. C’est également dans le second 19ème
que la maîtrise de l’acier et du ciment transformèrent peu à peu les
bâtiments et l’habitat. Au même moment, la distribution d’eau moderne
apparut dans les grandes villes, par des réseaux à faible pression
desservant les immeubles et riches demeures. C’est au 20ème
siècle que tous les foyers ont progressivement été équipés de l’eau
courante. Entamée dans les années 1920, l’expansion du réseau
énergétique a passé un cap avec la nationalisation d’EDF et GDF,
permettant un maillage complet du territoire et la desserte de la
quasi-totalité des demeures françaises.
Les progrès des conditions de vie et la
réduction du risque de maladies ont été appuyés, plus récemment encore,
par le développement de l’équipement domestique. Le nettoyage est
perfectionné par les aspirateurs et produits plus efficaces, diminuant
drastiquement les moisissures porteuses de germes. Les corvées les plus
pénibles sont assurées par les machines ; le lave-linge automatise le
nettoyage de vêtements, effectué beaucoup plus régulièrement.

L’évolution de la médecine et de
l’hygiène – par l’habitat – est une cause fondamentale de l’allongement
de la vie. L’espérance de vie ne dépassait pas 40 ans jusqu’en 1850 ;
elle a plus que doublé depuis. Une multitude de critères participent à
des degrés divers à ce phénomène, comme la forte réduction du nombre
d’accidents, l’assainissement de l’air des grandes villes depuis la fin
du 19ème, l’amélioration de la qualité alimentaire – mais ils
restent secondaires, et nous n’en ferons pas la somme. Il existe
néanmoins un autre facteur fondamental pour expliquer la hausse de la
longévité. Alors qu’il présente une importance similaire, voire
supérieure aux progrès médicaux, il est le plus souvent « oublié » par
ceux qui commentent les chiffres de l’espérance de vie. Il s’agit du
travail.
Conquêtes ouvrières et santé publique
L’activité principale d’un individu est
la condition première du nombre de printemps qu’il connaîtra.
Volontairement omis, ce fait est pourtant une évidence. La qualité et la
quantité du travail accompli par un homme vont déterminer sa santé et
sa longévité. L’évolution de l’espérance de vie est donc intimement liée
à l’évolution des conditions de travail. Autrement dit, si l’on vit
plus longtemps, c’est parce qu’on travaille moins.
Le travail lui-même a connu plusieurs
phases de transformation. Il s’est divisé en des métiers et des postes
plus précis, a exigé un niveau d’instruction plus élevé, s’est ancré
dans un processus de production plus étendu et efficace. En soi, le
passage du féodalisme de l’ancien régime au capitalisme moderne n’a pas
amélioré les conditions de travail, au contraire. La pénibilité, l’usure
sur la santé, ne trouvent aucune amélioration sensible entre un serf du
16ème siècle qui laboure sa terre et un salarié des mines, de la sidérurgie ou du textile du 19ème.
La condition du second est même certainement pire, en raison des
cadences accélérées, déterminées par la grande chaîne de production où
chacun n’est qu’un petit rouage, et les pressions pesant sur les
employés avec la menace permanente du licenciement. Le tournant dans
l’amélioration des conditions de travail est opéré avec l’apparition et
le développement des syndicats, organisations par et pour la classe
ouvrière elle-même, qui obtiendront satisfaction sur des points majeurs
de leurs revendications.
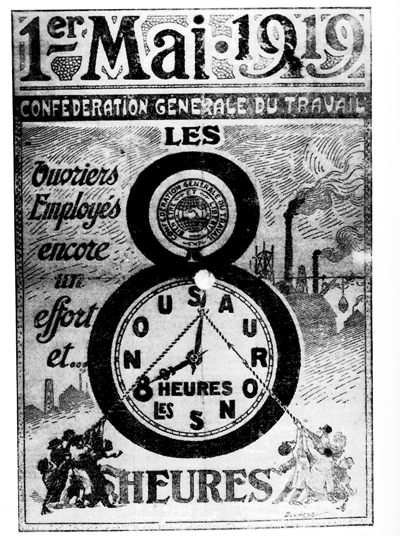
Le travail des enfants, omniprésent, ne
prend fin qu’après la loi du 2 novembre 1892 et l’interdiction stricte
d’employer des garçons et des filles de moins de douze ans. Jusqu’à 18
ans, le temps de travail hebdomadaire est limité à 60 heures par le même
texte législatif, qui sera appliqué sporadiquement dans ses premières
années. C’est néanmoins une première victoire d’envergure pour des
syndicats naissants, qui se rassemblent en 1895 sous la bannière de la
Confédération générale du travail (CGT). Dès lors, les ouvriers se
battent pour la journée de 8 heures, à une époque où la plupart d’entre
eux effectuent douze heures de travail journalier à un rythme éreintant.
De nombreuses grèves, mobilisations générales et interruptions de la
production sont nécessaires pour que le grand patronat – et ses délégués
politiques – accepte de céder à cette revendication, synonyme de manque
à gagner important. Il faut attendre 1946 pour que la semaine de 40
heures rentre définitivement dans la loi française ; néanmoins les
besoins de main d’œuvre dans la reconstruction du pays et les repères
culturels font que les employés travaillent bien au-delà, avec une
majoration pour leurs heures supplémentaires. Ce n’est qu’en 1963 que le
temps de travail hebdomadaire décline réellement. Le temps de travail
annuel, lui, avait déjà bien baissé. Revendiqués à partir de 1926 par la
CGT, les congés payés sont institués par le Front populaire à l’été
1936, suite à la grève générale qui a vu les premières occupations
d’usine. Deux semaines par an, les employés peuvent se reposer tout en
gardant leur paye ; c’est une évolution nette pour la capacité à
recouvrer ses forces, pour la santé des Français.
A la Libération, le Parti communiste
français est la première force politique tandis que la CGT revendique 5
millions et demi d’adhérents, soit un salarié sur deux. Les
nationalisations massives, permises par l’expropriation des grands
capitalistes qui ont collaboré activement avec l’envahisseur hitlérien,
permettent d’instaurer dans les grandes entreprises contrôlées
publiquement un rythme de travail moins pénible, et des règles plus
protectrices pour les travailleurs. Les fonctionnaires et agents publics
sont embauchés massivement, réduisant de facto la charge de travail
pesant sur chaque salarié. Certains groupes sont précurseurs, comme
Renault qui accorde à ses salariés trois, puis quatre semaines de congés
payés sous l’égide de Pierre Dreyfus, contre l’avis des pouvoirs
publics, et bien avant que ces avancées ne soient inscrites dans la loi.

C’est à la même époque, au sortir de la
seconde guerre mondiale, que la santé publique moderne est instaurée en
France. Le gouvernement provisoire, constitué en partie de communistes,
va substituer au système d’assurances sociales éclatées, un régime de
sécurité sociale universel. L’assurance maladie permet à tous les
salariés d’arrêter le travail, en touchant des indemnités pour absence
sur le poste en cas de santé défaillante, ce qui réduit sensiblement les
risques d’infection dans les entreprises. L’assurance vieillesse donne
aux vieux une retraite, assurée directement par les salariés actifs, ce
qui donne droit à des jours heureux à l’âge mûr – au lieu de
l’épuisement fatal dû au maintien acharné en activité. Les accidents du
travail sont reconnus et le patronat est tenu de les prendre en charge ;
pour s’éviter ces dépenses supplémentaires, il est contraint
d’améliorer la sécurité en entreprise. La consultation des médecins,
même spécialistes, et l’achat de médicaments prescrits deviennent
remboursés. Cette structure nouvelle, fonctionnant par la solidarité
nationale, va remarquablement réduire les maladies en nombre et en
gravité, et donc allonger formidablement l’espérance de vie.
Le temps de travail repart à la hausse
Depuis, les conquêtes ouvrières se sont
poursuivies. Résultant toujours de longues luttes revendicatrices menées
par le peuple travailleur lui-même, des mesures comme la cinquième
semaine de congés payés, la retraite à 60 ans et la semaine de 35 heures
ont été prises. Néanmoins, ce long processus de progrès social réalisé
aux 19ème et 20ème siècles s’est fragilisé, jusqu’à devenir inopérant.
Ce reflux s’explique par des raisons
structurelles : la conscience de classe s’est perdue chez les Français
avec la tertiarisation, la division syndicale a rendu les luttes
morcelées et peu combatives, le chômage très élevé achève les velléités
de lutte salariale au sein des entreprises. Organisées par et pour la
haute bourgeoisie, classe sociale des grands propriétaires de capitaux,
ces conditions nouvelles lui permettent de revenir sur ce qu’elle avait
cédé à la classe ouvrière sans jamais le digérer. La réduction du temps
de travail, en heures dans la semaine, en semaines dans l’année ou en
années dans la vie, représente un manque à gagner inacceptable pour le
grand patronat. La santé publique, parce qu’elle prive un secteur
économique entier de la soumission aux règles du marché et de la
génération de profits, n’est pas non plus envisagée dans l’idéal de
« libertés » pour lequel militent les multimilliardaires.

Le rapport de forces a largement évolué,
ces quarante dernières années, en faveur de la grande bourgeoisie
contre la classe ouvrière et la petite bourgeoisie – les petits patrons
et praticiens libéraux. Seule la classe intermédiaire des cadres et
dirigeants, qui assurent le tampon permanent dans la hiérarchie sociale,
croit trouver son compte à la tournure que prend l’économie
aujourd’hui. Toujours est-il que les grands propriétaires capitalistes
font, de plus en plus, la pluie et le beau temps en France, imposant
leurs revendications de « baisse de coût du travail », d’augmentation du
temps de travail, de levée des « contraintes » dans le fonctionnement
des entreprises, autant de conditions sine qua non pour entrer – selon
eux – dans le 21ème siècle.
A rebours de l’évolution historique, le
temps de travail augmente depuis quinze ans. Depuis le début des années
1990, des lois allongent la durée de cotisation et repoussent l’âge de
la retraite. La loi sur les 35 heures a été négociée contre
l’annualisation du temps de travail ; les nouveaux jours logiquement
chômés (réduction du temps de travail ou RTT) sont généralement échangés
contre une augmentation, pour pallier à la stagnation des salaires face
à une inflation galopante. Les heures supplémentaires, en principe une
exception, sont devenues la règle pour la grande majorité des employés –
si bien que le temps de travail hebdomadaire moyen, pour ceux sous
contrat à temps plein, est aujourd’hui supérieur à 39 heures. Les
mesures de défiscalisation successives et les relations
politique-patronat chaudement amicales, nourries par les gouvernements
de droite comme de gauche, poussent d’autant plus les « élites
économiques » à agir comme bon leur semble.
Progrès exclusifs et renoncement aux soins
La détérioration des conditions de
travail est en marche et impactera lourdement la santé des Français –
c’est le prix à payer pour être « compétitif », nous dira-t-on. Elle
n’est néanmoins pas la seule cause de la stagnation de l’espérance de
vie déjà constatée, ni de la baisse à venir.
Les progrès actuels de la médecine se
concentrent exclusivement dans des « niches » qui, par nature, ne
peuvent bénéficier à toute la population. Les prouesses de nos jours se
situent dans le domaine des organes bioniques, tels que le cœur
artificiel transplanté avec succès dans l’hexagone. Ce secteur
d’excellence fait dire à certains philosophes que l’Homme est proche de
battre la mort, avec la fabrication et la greffe de ces organes plus
performants et persistants que leurs homologues naturels. Mais ce
progrès certain ne sera toujours réservé qu’à une extrême minorité de la
population, précisément la plus riche. Parallèlement, les efforts de
recherche sur des problématiques qui touchent beaucoup plus largement la
population française, comme la lutte contre le cancer, ont tendance à
s’amenuiser sérieusement.
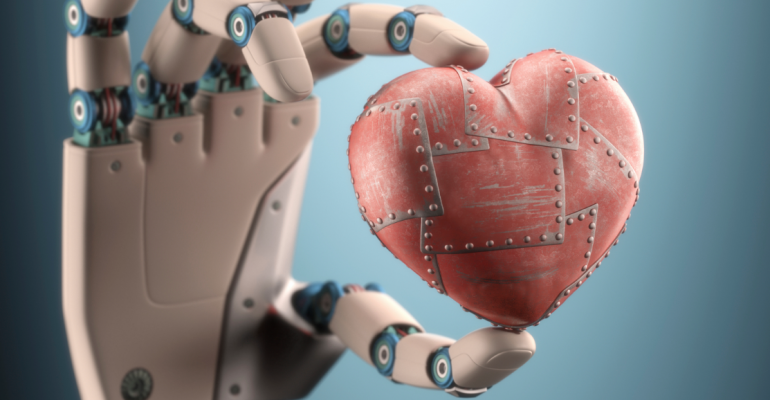
Outre les progrès à venir, les actes
médicaux eux-mêmes s’éloignent de plus en plus de la population. L’effet
de la médecine sur l’espérance de vie ne vaut qu’à condition que les
soins soient accessibles ; or, la santé est considérée davantage comme
un luxe à mesure que les services publics – à commencer par les hôpitaux
– font face à des restrictions budgétaires lourdes. Quand les
dirigeants de l’Etat décident de dépenser une somme importante pour des
raisons de santé publique, c’est en réalité moins dans l’intérêt des
Français que des laboratoires pharmaceutiques qui dominent sans partage
le marché de la médecine. Ainsi, la psychose autour de la grippe H1N1 en
2009 a vu le gouvernement commander 94 millions de doses du vaccin,
soit une facture d’un milliard d’euros. Le ministère, qu’il soit sous
l’égide de Roselyne Bachelot ou de Marisol Touraine, impose des
fermetures de services hospitaliers voire d’établissements entiers dans
certaines spécialités.
De moins en moins remboursés, les actes
et médicaments nécessitent des assurances complémentaires pour être
soutenables financièrement par les ménages. Le résultat est simple : les
Français se soignent moins. Le taux de renoncement augmente avec
constance depuis dix ans, tandis que les exigences dans l’entreprise
poussent les salariés malades à se rendre malgré tout au travail. Cela
ne signifie pas que moins d’arrêt maladie sont pris – au contraire, avec
l’explosion du nombre de dépressions chez les employés, en grande
partie en raison de la pression au travail. Dépressions et
antidépresseurs ont d’ailleurs tendance à réduire la longévité des
individus, tant ils épuisent psychologiquement et physiquement. Les
employés en poste y sont particulièrement sujet, avec au cours des
années 2000 une augmentation nette du nombre de suicides au travail pour
les cas les plus extrêmes ; mais les privés d’emploi sont, eux aussi,
particulièrement affectés par ces risques.
Enfin, le nombre de médecins, après
avoir augmenté sans faiblir pendant cinquante ans, baisse
considérablement depuis 2010. La première raison d’un tel déficit, qui
va impacter de plus en plus la raison des Français, réside dans le fait
que ce métier est contrôlé par une corporation petite-bourgeoise. Des
milliers de jeunes étudiants sont recalés chaque année à l’examen de fin
de première année des études de santé, en raison d’un numerus clausus
écrasant, que le gouvernement socialiste se refuse à remettre en cause.
La médecine est réservée à une petite élite qui défend farouchement ses
intérêts exclusifs, à l’encontre de l’intérêt général. La haute
bourgeoisie voit dans cet ordre établi une aubaine pour baisser la
voilure des services publics de santé ; tandis que ses laboratoires
pharmaceutiques « achète » d’autant plus facilement les médecins en
poste, par un arrosage permanent de cadeaux et privilèges.
Inégalité de classes devant la mort
Selon les rares enquêtes produites sur
la question, le taux de mortalité chez les chômeurs est radicalement
supérieur à la moyenne. Le phénomène n’est pas nouveau, mais il
s’aggrave. D’après une étude longue publiée par l’Insee il y a quinze
ans, le risque relatif de mortalité est passé de +3,5% entre 1975 et
1980 à +5,1% entre 1990 et 1995. Ce phénomène s’est depuis alourdi.
Selon Pierre Meneton, chercheur à l’Institut national de la santé et de
la recherche médicale (Insem), le chômage tue « entre 10.000 et 20.000
personnes par an ». Son étude, réalisé entre 1995 et 2007 et portant sur
6.000 volontaires âgés de 35 à 64 ans, montre une « surmortalité très
importante ». Etre privé d’emploi a « des effets majeurs sur la survenue
d’accidents cardiovasculaires et de pathologies chroniques ». Et
encore, pour l’auteur, ces résultats alarmants ne sont qu’une
« sous-estimation de la réalité », qui serait bien plus fatale. Avec
près de dix millions de chômeurs en France – entre les six millions
d’inscrits à Pôle Emploi et ceux qui ont renoncé à l’être – soit un
record historique jamais atteint, et toujours en hausse, la mortalité
des Français commence à croître dangereusement.

L’Insee s’interdit de mener des études
plus complètes sur le sujet, par exemple en comparant les espérances de
vie par catégorie sociale. Pourtant, toutes les enquêtes montrent la
prédominance de l’activité principale dans la santé des individus. Selon
une enquête sur les centenaires réalisée à Göteborg, en Suède et dont
les résultats ont été rendus publics en début de mois, le premier
facteur déterminant une telle longévité est « le statut social à 50
ans ». Le « statut » est un euphémisme pour désigner la classe sociale.
Que l’on ait été mineur de fond ou bourgeois mondain ne revient
effectivement pas au même train de vie et à la même usure sur le corps.
Deuxième critère : avoir été en « bonne forme physique ». Autant dire
que le premier conditionne le second dans l’écrasante majorité des cas.
En France, seule la comparaison
géographique permet d’entrevoir les inégalités de classe devant la mort.
Les études faites par « catégories socioprofessionnelles », qui
mélangent dans une même ligne tous les patrons et artisans sans prise en
compte du nombre d’employés, ne permettent en aucun cas une distinction
des classes sociales. Néanmoins, les données montrent chez les cadres
et les « artisans, commerçants, chefs d’entreprise » (sic) le plus gros
écart d’évolution, ces catégories gagnant respectivement 5,5 et 5,2
années d’espérance de vie, là où les « inactifs non retraités » déjà les
moins bien lotis, ne gagnent que 2,7 ans. Ce dernier groupe avait donc
une espérance de vie moyenne de 65,4 ans sur la période 2000-2008,
contre 82,2 ans pour les cadres.
Selon les données recensées entre 2010
et 2012, l’espérance de vie diffère largement selon les départements.
Chez les hommes, le trio de tête est Yvelines, Paris et Hauts-de-Seine,
tous au-dessus de 80,3 ans. En queue de classement, le Nord et la Guyane
sont autour de 75,5 ans tandis que le Pas-de-Calais pointe à 74,4 ans.
Soit six ans et demi de moins, en moyenne, que les Hauts-de-Seine. La
différence chez les femmes est moins flagrante mais réelle, allant de 82
ans et demi dans le Nord-Pas-de-Calais à plus de 86 ans dans la
capitale française. Inutile de plier bagage pour rejoindre
l’Île-de-France : ce n’est pas la qualité de l’environnement qui
explique un tel écart mais bien le statut, ou plutôt la classe sociale.
La région capitale voit, logiquement, une concentration de la grande
bourgeoisie dont le train de vie faits de brunchs et cocktails abîme
moins le corps qu’une journée de travail, fût-elle dans un magasin ou
dans un bureau en open-space. Il faut encore préciser que même à Paris
ou dans les Hauts-de-Seine, la haute bourgeoisie n’est qu’une infime
minorité de la population, et que sa capacité à tirer en avant la
moyenne de la population montre comment elle survit mieux à notre monde
que la classe ouvrière contemporaine.
Le Royaume-Uni est un exemple de liberté
économique pour les grands propriétaires français. Le système de
sécurité sociale, quasiment inexistant, oblige selon les tenants du
capitalisme à se forger un destin par soi-même, sans assistance. Ce
refus de la solidarité nationale est également ravageur. C’est à Glasgow
qu’a été mesurée l’espérance de vie la plus basse d’Europe, en-dessous
des moyennes nationales des pays « pauvres » de l’Est. Les hommes de la
capitale économique écossaise affichaient en 2008 une longévité de 70
ans, en prenant compte des quartiers d’affaires. Ceux du quartier
ouvrier de Calton présentaient quant à eux une espérance de vie de 53,9
ans. Sur place, les bourgeois et leurs perroquets imbéciles répètent que
les pauvres cherchent eux-mêmes à se détruire la santé par leur
surconsommation d’alcool, de tabac et de fish and chips. Ils préféraient
ne pas mettre l’accent sur les 30% de chômage et 38% de foyers sans
revenu recensés cette même année dans le quartier.

En France, le sujet n’intéresse pas le
grand patronat et ses délégués politiques, de droite ou socialistes, qui
rêvent de reproduire dans l’hexagone les conditions de la croissance
britannique. Ils ont de quoi se réjouir, car c’est exactement ce vers
quoi nous nous orientons. Le modèle de liberté et d’efficacité
économique qu’ils sont en train de nous imposer, par force réformes
structurelles et coupes budgétaires, est pour le moins singulier. Cet
idéal, bientôt réel, sert définitivement plus la liberté pour le gros
employeur de ne pas respecter de « contraintes » de sécurité et
d’hygiène trop « strictes », plutôt que la liberté pour le travailleur
moyen de profiter d’une vie en bonne santé.
A contre-courant des considérations abstraites, l’espérance
de vie est un phénomène socio-économique résultant de facteurs
spécifiques. Ce n’est donc pas une surprise si elle a baissé en 2012,
stagne depuis, et risque de connaître bientôt une diminution continue.
L’augmentation du temps de travail et le renoncement aux soins vont
finir par atrophier sérieusement la santé des Français, précisément ceux
qui appartiennent à la classe ouvrière contemporaine – celle qui subit
des pressions au travail dans les magasins, les centres d’appel, les
administrations ou qui se trouve privée d’emploi. C’est le prix à payer
de notre époque, dont l’idéologie dominante ne rencontre pas de
résistance dans la population. Pour imposer un idéal profitable
exclusivement aux plus riches, nos dirigeants sacrifient notre
longévité. Avec le consentement général.
B.D.



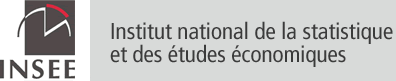


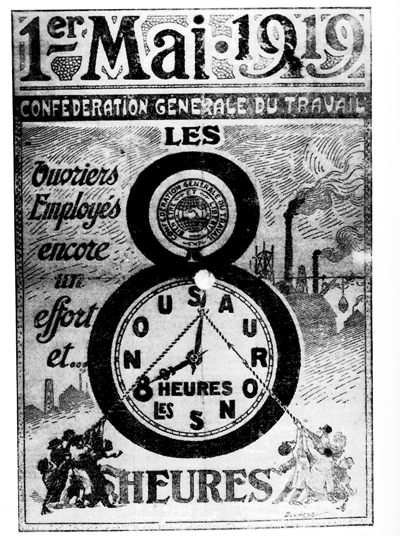


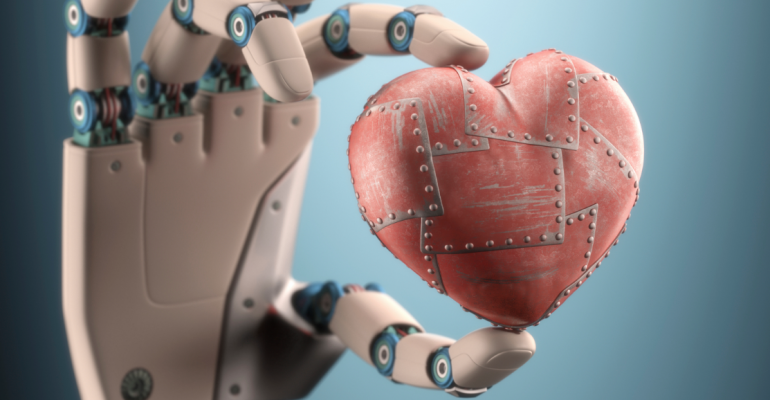




















 Si
vous ne souhaitez pas voir augmenter le nombre et la taille des
panneaux publicitaires, notamment numériques, hâtez-vous de participer à
la consultation publique sur le projet de décret sur l’affichage
publicitaire de la loi Macron
Si
vous ne souhaitez pas voir augmenter le nombre et la taille des
panneaux publicitaires, notamment numériques, hâtez-vous de participer à
la consultation publique sur le projet de décret sur l’affichage
publicitaire de la loi Macron
