Alors
que la presse française titube, l’exigence s’affirme d’un modèle
radicalement différent. Quel serait son cahier des charges ? Produire
une information de qualité soustraite à la loi du marché comme aux
pressions du pouvoir, loger numérique et papier à la même enseigne,
inventer un mode de financement solide et juste. Surprise, les outils
nécessaires à la mise en place d’un tel système sont sous nos yeux.
Naguère, les nouveaux riches soucieux de parfaire leur intégration à
la bonne société s’offraient un haras, une voiture ancienne ou une villa
à Cabourg. Désormais, pour asseoir leur statut, ils s’achètent un
journal. MM. Bernard Arnault et François Pinault, deuxième et troisième
fortunes françaises, ont depuis longtemps chacun le leur, respectivement
Les Echos et
Le Point. Les voici rejoints par de nouveaux
venus, MM. Xavier Niel et Patrick Drahi, industriels des
télécommunications, renfloueurs respectifs du
Monde (2010) et de
Libération
(2014). Financiers autant que philanthropes, ils ont inauguré leur
magistère par une réduction drastique des dépenses. Paradoxe : les
moyens techniques et intellectuels nécessaires pour produire et diffuser
une information de qualité abondent ; mais, à de rares exceptions près,
la presse imprimée et numérique chancelle, incapable de juguler la
dégradation de ses contenus et de stabiliser son assise économique.
À s’en tenir aux trois dernières décennies, on repère une séquence
presque toujours identique. Un journal, ou un groupe de presse, frappé
par la baisse des ventes ou l’amenuisement de ses ressources
publicitaires cherche des capitaux ; l’arrivée d’un investisseur
s’accompagne d’un plan social et de la réduction des moyens
rédactionnels ; le titre redémarre avec une dépendance accrue vis-à-vis
du pôle économique.
« Nous connaissons assez le capitalisme pour savoir qu’il n’y a pas de séparation entre le contrôle et la propriété », expliquaient les rédacteurs du
Wall Street Journal
(1er août 2007) après la reprise du quotidien d’affaires par le magnat
de la presse Rupert Murdoch. Et la routine reprend, jusqu’à la prochaine
crise.
Libération a été racheté successivement par M. Jérôme Seydoux
en 1995, par M. Edouard de Rothschild en 2005, puis par MM. Bruno Ledoux
et Drahi en 2013-2014, comme on se repasse une patate chaude — encore
que ses colonnes évoquent plutôt une purée tiède. Au
Monde, les
restructurations du capital s’enchaînent à un rythme quasi quinquennal :
1985, 1991, 1995, 1998, 2004, 2010. En l’espace d’une décennie,
Les Echos, Le Figaro, L’Express, Marianne, Le Nouvel Observateur
ainsi qu’une ribambelle de quotidiens régionaux et d’hebdomadaires
locaux ont eux aussi tendu les bras vers le même horizon, la même
illusion : s’acheter un surcroît de survie au prix d’un nouveau
propriétaire. Pour
La Tribune et
France-Soir, le rideau final est tombé [
2].
Le modèle mixte expire
À en croire les analystes dominants de la presse, deux facteurs
favorisent les sinistres à répétition. Le premier tiendrait au poids
écrasant du Syndicat du livre, qui pousserait l’inconvenance jusqu’à
payer les ouvriers d’impression et de distribution presque aussi bien
que des cadres. Le second remonterait à l’immédiat après-guerre et aux
fameuses ordonnances de 1944 : le propriétaire d’un quotidien
d’information générale et politique ne peut posséder un autre titre de
cette catégorie. Dit autrement, l’État proscrit alors la concentration
de la presse la plus sensible sur le plan idéologique et politique.
Cette disposition, conforme aux préconisations du Conseil national de la
Résistance, fut transgressée par des personnages comme Robert Hersant,
qui bâtit un empire en rachetant des quotidiens régionaux à coups de
millions gagnés dans la presse magazine, non concernée par les
ordonnances. Entre autres effets pervers, expliquent les adversaires de
la réglementation, ces dispositions auraient engendré une
sous-capitalisation structurelle de la presse française. Ainsi les
journaux pâtiraient-ils de l’absence de groupes médiatiques capables, à
l’instar de Springer et de Bertelsmann en Allemagne, de Pearson au
Royaume-Uni ou de News Corporation de M. Murdoch, d’absorber les chocs
de la conjoncture. Pareille défaillance aurait ouvert la voie aux
amateurs de danseuses qui s’offrent un journal non point comme un actif
mais comme un levier d’influence [
3].
Ni les dérives de la presse contrôlée par M. Murdoch ni les
restructurations du capitalisme médiatique outre-Rhin n’ont entamé la
certitude des dirigeants de la presse française : chacune de leurs
difficultés, pensent-ils, appelle une solution financière au coup par
coup. Et qu’importe le sort du concurrent si l’on parvient à restaurer
pour un temps ses fonds propres. Avec la montée en puissance du
numérique et l’évaporation des ressources publicitaires, il devient
difficile d’échapper à l’évidence : le véritable problème se pose non
pas à l’échelle d’un titre en particulier mais à l’ensemble de la
production d’information ; il ne provient pas d’une sous-capitalisation
mais, précisément, des contraintes exercées par la capitalisation
elle-même.
Pareille cécité tient à une ambivalence vieille de deux siècles :
l’information est pensée comme un bien public, mais produite comme une
marchandise. Substrat indispensable à la formation des jugements
politiques, elle concourt à forger des esprits libres, des imaginaires
collectifs, des groupes mobilisés. C’est l’arme à mettre entre toutes
les mains. Et parce qu’aucune société émancipée ne saurait s’en priver,
l’Assemblée constituante de 1789 proclame que
« la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme » et que
« tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement » [
4].
Hélas, le législateur, toujours plus à l’aise dans la poésie des idées
que dans la prose du quotidien, n’a pas sanctuarisé les moyens de son
ambition. Enquêter, corriger, mettre en pages, stocker, illustrer,
maquetter, administrer et, en ce qui concerne la presse imprimée,
fabriquer et distribuer, tout cela coûte cher. Et bientôt le droit
« universel » de
« répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit [
5]
» se mue en un privilège — celui d’une poignée d’industriels suffisamment fortunés pour s’offrir les grands moyens d’information.
Au fil du temps, le double caractère idéalement collectif et
concrètement marchand de l’information s’est sédimenté sous la forme
d’une tension entre le marché et l’État. Le premier produit et diffuse ;
mais sa logique de course à l’audience par le racolage tire la qualité
vers le bas. Le second régule, avec un zèle mollissant, et subventionne,
mais sans discernement : 1,6 milliard d’euros accordé chaque année à
l’ensemble du secteur. Pour les périodiques d’information politique et
générale, les subsides représentent plus de 19 % du chiffre d’affaires.
La persistance de ces aides publiques massives mais passives exprime la
reconnaissance implicite d’une situation dérogatoire au droit commun des
affaires : pas plus que l’éducation ou la santé, l’information de
qualité ne saurait s’épanouir sous la férule de l’offre et de la
demande. Détourné de l’intérêt général vers les conglomérats
commerciaux, le modèle mixte expire [
6].
Sur quelles bases économiques construire un nouveau système
respectueux du cahier des charges minimal qu’imposent les leçons de
l’histoire, une information conçue comme bien public échappant
simultanément aux contraintes économiques et aux pressions politiques de
l’État ?
La question fouette les imaginations depuis des lustres : nationalisation des infrastructures proposée par Léon Blum en 1928
(lire « M. Valls aurait-il osé ? »), création de sociétés de presse à but non lucratif réclamée par les sociétés de rédacteurs dans les années 1970 [
7],
mise en place d’une fondation nationale. À rebours des rêveurs, et
alors que la poussée numérique porte le système au bord de l’éclatement,
les gouvernements successifs limitent leur audace à la pose de
rustines.
Paradoxalement, imaginer une refondation pérenne des médias écrits
d’intérêt général ne requiert pas un effort d’imagination surhumain.
Trois éléments permettent de charpenter un cadre. Le premier consiste à
distinguer radicalement la presse d’information ayant vocation à
alimenter le débat public de la presse récréative. Si les deux genres
peuvent se prévaloir d’une égale dignité, seul le premier joue un
rôle-clé dans l’exercice par tous de la chose publique, ce qui fonde sa
légitimité à percevoir des financements de la collectivité. Sur les 4
726 publications recensées en France par la direction générale des
médias et des industries culturelles en 2012, à peine plus de 500
répondaient à la qualification de presse nationale ou locale
d’information politique et générale, dont 75 quotidiens et près de 300
hebdomadaires. Le reste mêle publications spécialisées grand public ou
techniques, un océan de papier où 838 trimestriels de loisirs et 181
mensuels consacrés aux services marchands voisinent avec une poignée de
périodiques ayant sans doute vocation à migrer dans la première
catégorie.
L’administration fiscale reconnaît d’ailleurs implicitement la
distinction dans l’article 39 bis A du code des impôts, puisque celui-ci
circonscrit l’exonération sur les bénéfices aux sociétés
« exploitant
soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au
maximum mensuelle consacrée pour une large part à l’information
politique et générale, soit un service de presse en ligne (…)
consacré pour une large part à l’information politique et générale ».
Allons un peu plus loin : les titres consacrés au divertissement
assumeront leur statut de marchandise, ceux dévolus à l’information
revendiqueront celui de bien collectif, avec ses servitudes et son…
Service commun.
Car le deuxième principe du modèle proposé repose sur la création
d’un service mutualisé d’infrastructures de production et de
distribution de l’information. Du journaliste au kiosquier ou à la page
Web, la presse forme une chaîne humaine et technique. Situés au centre
du processus, les travailleurs intellectuels négligent volontiers les
autres maillons. D’autant que la division technique et sociale du
travail mise en place après la seconde guerre mondiale a peu à peu
entériné la séparation des activités d’impression, de diffusion, de
gestion des abonnements (généralement externalisées), de développement
informatique, enfin de production du journal proprement dit. Cette
dispersion conduit à une impasse.
Le Service commun procurerait aux journaux — imprimés ou en ligne —
non seulement les imprimeries, le papier, les messageries qui acheminent
les liasses, une partie des kiosques, mais également des locaux, des
serveurs, des outils de stockage et de diffusion, des moyens de
recherche et de développement. Il fournirait à toutes les entreprises de
presse d’intérêt général les services administratifs, comptables,
juridiques, commerciaux, et opérerait une plate-forme commune
d’abonnement, de paiement et de gestion de bases de données. Il
rémunérerait des techniciens, des développeurs et des « bidouilleurs »
informatiques qui, tout en restant intégrés au sein des équipes de
chaque titre, collaboreraient pour améliorer les applications, accroître
la qualité et la puissance du kiosque en ligne, s’assurer de la
sécurité des données personnelles, améliorer la lisibilité des sites et
inventer de nouvelles conceptions graphiques. Le Service intégrerait
l’ensemble de la filière. De haut en bas, il engloberait les
infrastructures de l’Agence France-Presse et prendrait en charge le
salaire, enfin porté à un niveau décent, des kiosquiers. Au centre, il
financerait celui des correcteurs, secrétaires de rédaction,
maquettistes, photograveurs, graphistes… dont les postes se trouvent
actuellement menacés d’éradication par la course à l’automatisation,
mais sans lesquels un texte prend des allures de fleuve gris.
Dans ces conditions, la masse salariale des entreprises de presse se
réduirait aux seuls journalistes — encore que cette exception, qui vise
essentiellement à tuer dans l’œuf le soupçon de soviétisme qu’une telle
organisation collective ne manquera pas d’éveiller chez les défenseurs
de l’irréductible individualité des rédacteurs, ait vocation à se
résorber. En attendant, la différence d’employeur n’affecterait pas les
collectifs de travail : les équipes ne seraient pas séparées en fonction
de leur mode de rémunération et continueraient à travailler sous le
même toit.
Partager les infrastructures
En matière d’impression, d’administration et de logistique, la
mutualisation engendrerait d’importantes économies d’échelle. Du reste,
son principe ne représente pas une percée conceptuelle inédite : de
nombreux services et industries de réseau (télécoms, transports,
énergie) mutualisent des infrastructures coûteuses à construire et à
entretenir. Si la concurrence règne en aval parmi les acteurs, tous
empruntent le même réseau, qui forme ce que les économistes appellent un
« monopole naturel » — chaque compagnie aérienne ne construit pas son
aéroport. Côté numérique, le Service s’accorde harmonieusement avec le
style de travail collaboratif des développeurs de logiciels libres
habitués à partager leurs trouvailles ; sa centralisation et ses moyens
lui font remplir l’obligation de sécurité et de confidentialité des
données personnelles plus facilement que dans la configuration actuelle,
où s’empilent des dizaines de prestataires privés. Au moment où les
géants du Web transforment ces informations en marchandise, cette
qualité ne relève pas de l’anecdote.
À qui profiterait la mutualisation et à quelles conditions ? À toute
la presse d’information d’intérêt général, sans distinction d’opinion,
de prestige ou de taille, pourvu que ses éditeurs adoptent le statut
d’entreprise à but non lucratif (le bénéfice n’est pas distribué aux
actionnaires), ne possèdent pas plus d’un titre dans chaque type de
périodicité (quotidien, hebdomadaire, etc.) et proscrivent toute
publicité de leurs colonnes ainsi que de leurs écrans. C’est-à-dire non
seulement la réclame classique, sous forme d’inserts, de bannières ou de
vidéos surgissantes, mais également les diverses formes d’écriture
publirédactionnelle que les services marketing promeuvent au sein des
rédactions. L’intention ici n’est pas de réduire l’information à un
noyau sec dépourvu de pulpe, d’imprévu et de fantaisie, mais plutôt de
s’assurer qu’elle réponde au désir des rédacteurs et à l’intérêt des
lecteurs plutôt qu’aux exigences des annonceurs.
La mise en place de ce modèle provoquerait à coup sûr un grand
courant d’air frais : créer ou reprendre un journal ou un site
d’information serait d’autant plus facile que les dépenses se
limiteraient aux salaires des seuls journalistes, le reste étant fourni
par le Service. Enfin pourvue de moyens, la presse « alternative »
pourrait sortir des marges.
Comment financer le Service ? C’est le troisième et dernier pilier du
système, le point où s’apprécie la crédibilité de l’ensemble. Dans notre
schéma, les recettes des ventes couvrent les salaires des journalistes
ainsi qu’une partie des dépenses mutualisées (environ la moitié,
lire « Vers la cotisation information »).
Reste à trouver une source pérenne qui remplace à la fois les aides
publiques, supprimées, et la publicité, abolie. Il faut écarter d’emblée
deux solutions souvent avancées en pareilles circonstances : d’une
part, l’impôt, qui présente le risque de soumettre l’information à une
tutelle trop directement politique ; d’autre part, la philanthropie —
dont dépendent par exemple la plate-forme d’enquête ProPublica et
l’organisation First Look Media —, qui subordonne le sort de
l’information à la générosité de quelques milliardaires.
Le mode de financement qui ne doit rien au marché ni à l’État existe
déjà : la cotisation sociale. Sa puissance a fondé le succès de la
Sécurité sociale et assuré le versement depuis des décennies des
pensions de retraite. Le sociologue Bernard Friot [
8]
y voit à la fois le produit des luttes sociales passées et l’embryon
d’une société enfin soustraite aux forces du marché. Les gouvernants
s’acharnent sur cette preuve en actes que le tous-pour-chacun fonctionne
au moins aussi bien que le chacun-pour-soi. Contrairement à l’impôt, la
cotisation socialise une partie de la richesse produite par le travail
avant que les salaires ne soient payés et le capital rémunéré. Versée
aux caisses (santé, retraite, famille), elle n’entre pas plus dans les
budgets de l’État qu’elle ne sert de support spéculatif. Pourquoi,
plaide Friot, ne pas étendre ce schéma à l’ensemble de l’économie ? En
attendant que le rapport de forces politique permette l’accomplissement
d’un tel projet, une application sectorielle s’envisage aisément : la
création d’une cotisation information financera le Service. Au fond,
quoi de plus logique que cette conquête sociale prenne en charge un bien
collectif ?
Ni impôt ni publicité
D’autant que l’effort n’en serait pas un. Nos calculs
(lire « Vers la cotisation information »)
montrent que les besoins annuels de financement s’élèvent à 1,9
milliard d’euros, un chiffre à comparer au 1,6 milliard d’aides à la
presse, lesquelles seront supprimées. Ce montant correspond à un taux de
cotisation information de 0,1 % assis sur la valeur ajoutée et acquitté
par toutes les entreprises et administrations. Pour la collectivité, la
différence avec le modèle en vigueur représente donc un surcoût de 300
millions d’euros. C’est le prix d’une information libre : moins d’un
tiers de la rallonge budgétaire de 1 milliard d’euros accordée par le
gouvernement à Dassault en janvier dernier pour moderniser le
chasseur-bombardier Rafale…
Dès lors, les sociétés de presse d’intérêt général n’auraient plus
pour seule dépense que les salaires des journalistes, que financerait la
vente des journaux en ligne ou imprimés — l’excédent étant reversé au
Service. Quant aux formidables économies d’échelle engendrées par la
mutualisation, elles se traduiraient par une baisse significative du
prix des journaux en ligne et imprimés.
Aux sceptiques qui jugeraient irréaliste l’idée d’un financement par
une nouvelle cotisation, il n’est sans doute pas inutile de rappeler
que, au-delà du système paritaire hérité de l’après-guerre, elle fut
discrètement mise en œuvre en 2010 par… M. Nicolas Sarkozy pour
remplacer la défunte taxe professionnelle. Ce prélèvement, baptisé
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), s’applique
actuellement aux sociétés à un taux variant entre 0,5 % et 1,5 % en
fonction du chiffre d’affaires. Son produit, alloué au financement des
investissements locaux (routes, ponts), a dépassé les 15 milliards
d’euros en 2013, mais il ne fait pas l’objet d’une gestion paritaire et
fonctionne comme un impôt.
Différenciation radicale entre presse d’intérêt général et presse de
divertissement, création au bénéfice de la première d’un service
mutualisé d’infrastructures, financement par une cotisation
information : ces piliers reposent sur des principes juridiques et des
outils fiscaux qui existent. Ils esquissent un système capable de
conjuguer qualité et pérennité, adapté aussi bien à l’imprimé qu’au
numérique, potentiellement extensible à l’audiovisuel ainsi qu’aux
plates-formes de diffusion vidéo numérique. Ils limitent l’appropriation
privée des moyens écrits d’information d’intérêt général sans pour
autant en transférer le contrôle à l’État : les entreprises de presse
demeurent dans leur diversité mais avec un statut non lucratif, un
périmètre salarial restreint aux journalistes, une interdiction de la
concentration. L’appropriation privée des médias écrits telle qu’elle se
pratique en France depuis des décennies relève d’ailleurs plus de la
prestidigitation que du capitalisme d’investisseurs, puisque, tous
comptes faits, les sommes versées par les industriels pour acheter la
presse s’avèrent bien maigres comparées aux prodigalités publiques.
MM. Bergé, Niel et Pigasse ont acheté
LeMonde en 2010 pour 60
millions d’euros ; entre 2009 et 2013, l’État a versé 90 millions
d’euros à ce groupe (sans compter les aides indirectes). Cette année,
M. Drahi a déboursé 14 millions d’euros pour acquérir une moitié du
capital de
Libération ; mais, rien qu’entre 2012 et 2013, la
puissance publique a gratifié ce quotidien souffreteux de 20 millions
d’euros. Si la règle du « qui finance contrôle » s’appliquait, l’État
serait propriétaire d’un très vaste groupe de presse… Notre modèle remet
l’économie à l’endroit : la collectivité (par la cotisation) et les
usagers (par l’achat) financent les infrastructures communes et
jouissent de la concurrence des idées.
La mise en œuvre concrète de l’édifice soulève à l’évidence quantité
d’objections. Comment, par exemple, distinguer sans ambiguïté les
publications vouées à l’information des titres récréatifs ? Si le
renoncement obligatoire à toute forme de publicité opère un tri, des
zones floues persistent. En outre, les modalités de séparation s’avèrent
délicates : nombre de groupes produisent à la fois une presse
informative et une presse récréative, les deux disposant de services
communs. La création du Service, l’abolition des aides publiques, la
non-lucrativité et la déconcentration inciteraient probablement les
industriels à se séparer de l’information pour se recentrer sur le
secteur récréatif et spécialisé, lequel bénéficierait du transfert de la
publicité bannie des titres d’intérêt général (plus de 1,4 milliard
d’euros en 2013 pour la seule catégorie presse d’information politique
et générale, une somme largement suffisante pour compenser la
suppression des aides d’État).
Qui dirigerait le Service, cet organisme mutualiste comptant à la
fois plusieurs milliers de salariés et une grande variété de métiers ?
Un mode de gestion paritaire, tel qu’il fut expérimenté au sein des
caisses de Sécurité sociale entre 1945 et 1960, découle assez
logiquement du mode de financement par la cotisation. Des représentants
élus des diverses branches du Service, mais aussi des éditeurs, des
journalistes, des lecteurs définiraient ensemble les besoins à
satisfaire, les orientations à prendre, les investissements à réaliser.
Mais comment éviter la bureaucratisation, comment engendrer une
dynamique commune à des métiers héritiers de traditions fortes mais
éclatées ? Arbitrer les conflits et réguler l’allocation des moyens du
Service aux publications requiert des instances reconnues par tous comme
légitimes.
Le modèle proposé ici laisse plus de trois points en suspension… Nul
ne peut prétendre isoler hermétiquement un secteur des pesanteurs du
régime économique et des pouvoirs publics, comme l’éprouvent
quotidiennement les personnels d’enseignement, de santé ou de recherche.
Il serait toutefois naïf d’attendre qu’un bouleversement social propage
ses ondes de choc jusqu’aux industries de la communication pour bâtir
un modèle d’information rationnel et désirable. D’autant que, par leur
fonctionnement actuel, les médias font obstacle au changement. Notre
esquisse lève cet obstacle et propose une application sectorielle, en
attendant mieux, d’une économie mutualisée. Avec l’espoir de démentir
enfin l’écrivain autrichien Robert Musil, qui déplorait il y a déjà près
d’un siècle :
« Les journaux ne sont pas ce qu’ils pourraient être à
la satisfaction générale, les laboratoires et les stations d’essai de
l’esprit, mais, le plus souvent, des bourses et des magasins [
9]. »
Pierre Rimbert











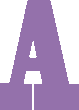 l’occasion
de l’assemblée générale de Total le 29 mai 2015, l’Observatoire des
multinationales publie son premier « rapport annuel alternatif », en
collaboration avec les Amis de la Terre France. Cette publication entend
mettre en lumière le véritable bilan du groupe pétrolier français, y
compris les conséquences sociales et environnementales de ses activités.
l’occasion
de l’assemblée générale de Total le 29 mai 2015, l’Observatoire des
multinationales publie son premier « rapport annuel alternatif », en
collaboration avec les Amis de la Terre France. Cette publication entend
mettre en lumière le véritable bilan du groupe pétrolier français, y
compris les conséquences sociales et environnementales de ses activités.







